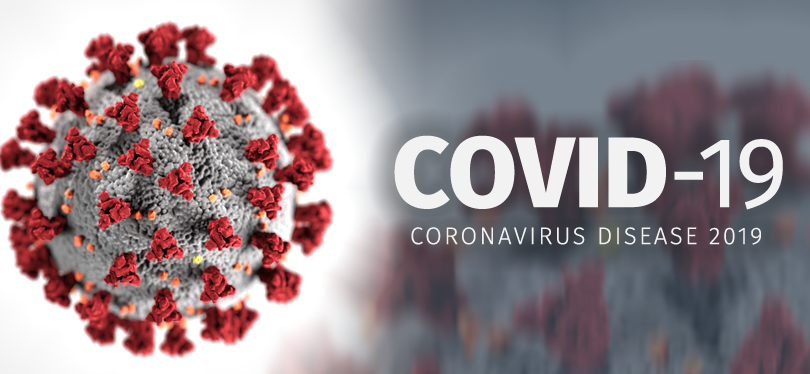Nous ne sommes pas égaux devant la crise sanitaire que traverse actuellement le Cameroun. Ni face aux risques de contamination (le personnel médical a peu de ressources. Très peu de camerounais ont accès à l’eau potable. Le prix des gels et des masques demeure également hors de portée pour un nombre important de la population), ni face au confinement (la réalité n’est pas la même entre ceux qui peuvent se confiner dans de grandes maisons et pour ceux qui doivent cohabiter dans une promiscuité extrême ; entre ceux qui peuvent faire des réserves de denrées alimentaires et ceux qui vivent au jour le jour), ni face aux conséquences socio-économiques (perte de revenus et d’emploi). Malgré l’ébranlement commun, l’expérience simultanée de la vulnérabilité et la rencontre collective du tragique, il n’y pas d’égalisation des conditions de lutte contre l’ennemi qui avance masqué. S’il est vrai que le COVID-19 peut potentiellement frapper tout le monde, il n’en demeure pas moins que les moyens pour y faire face le cas échéant sont fonction du statut social (Cf. taux de morbidité en Seine-Saint-Denis en France ou des populations noires aux USA). Le confinement, la distanciation sociale et autres mesures barrières sont définies et vécues de manière inégales. Il faut en tenir compte au moment où s’ouvre à peine sous nos cieux le défi de la riposte à une pandémie aux conséquences socio-politiques insoupçonnées. C’est non seulement une exigence éthique, mais aussi un enjeu de stabilité sociale et politique. Je m’empresse de vous dire pourquoi.

Crise économique et sociale
La loi de finances 2020 a été rédigée sur l’hypothèse d’un baril à 54$. Or, le 1 avril 2020 le baril oscillait autour de 20$. La chute drastique des recettes fiscales et douanières en raison de la fermeture des frontières et du ralentissement sans précédent de l’activité économique est de plus en plus manifeste. Le prix de certains produits de première nécessité explose. L’économie de la nuit est au bord de la faillite. Le secteur de l’hôtellerie et du divertissement est quasiment à l’arrêt sans bien savoir quand il pourra à nouveau fonctionner. Au cours des prochaines semaines, de nombreux entrepreneurs, employés, transporteurs (inter)urbains, journalistes, commerçants et débrouillards de l’informel, etc. perdront leurs emplois et revenus. Autant dire que la crise sanitaire actuelle est grosse d’une crise économique. Déjà en proie à une malgouvernance hybride, une crise postélectorale non soldée et une guerre civile larvée (région anglophone), l’absence d’un plan de soutien (économique et social) pour l’immense majorité de la population pourrait induire une déflagration sociale.
S’il est vrai que l’analyse des conditions d’émergence de révoltes sociales s’accommode mal d’une approche exclusivement monocausale, on peut néanmoins affirmer à la lumière des émeutes de 2008 que l’exacerbation des inégalités sociales et la rareté (objective ou subjective) des ressources sont les ingrédients d’une dislocation sociale et politique. Confronté depuis longtemps à un problème de violence, soit comme réalité à contenir (en raison de la pauvreté, du népotisme, inégalités sociales persistantes et multiples frustrations relatives), soit comme menace à écarter (en raison du déficit de confiance et de légitimité dont il souffre), le régime de Yaoundé pourrait difficilement contenir de nouvelles émeutes de la faim.
Dès lors que lui reste-t-il comme marge de manœuvre pour conjurer les effets potentiellement explosifs d’une crise sanitaire sans précédent? La prévention.
Il ne s’agit pas de recourir à un logiciel policier et répressif comme le suggère certains universitaires proches du pouvoir anomique de Yaoundé. Dans les circonstances d’une crise socio-économique longue et sévère, une telle option ne ferait pas long feu. Bien au contraire, elle pourrait attiser le brassier et ouvrir la voie à une révolte potentiellement dramatique.
La révolte
Il n’est peut-être pas inutile de rappeler à ce niveau qu’une révolte se manifeste toutes les fois où les discours et pratiques politiques ordonnés selon les oukases autoritaires, dévoilent leur épuisement répressif face au besoin simple, pressant et strident de manger, boire, dormir, copuler, rêver en santé.
Elle apparait comme la conséquence d’une fixation arbitraire et permanente d’un groupe d’individus dans un ordre social inégal, injuste et de surcroît immuable. En fait pour de nombreux peuples, la révolte est souvent l’occasion de rompre avec leur misérable routine et leur ressentiment intérieur accumulé. Tout événement-révolte s’alimente bien avant et trop souvent de l’injustice sociale en tant qu’impossibilité pour un peuple de satisfaire ses besoins vitaux et d’aspirer à un nouveau contrat social. C’est la traduction évènementielle du refus exprimé de voir perdurer une situation sociale qui l’asphyxie ou l’enferme dans une situation de stress permanent. C’est le « rejet radical de la brutalité́ normale à laquelle nos existences sont exposées et qu’un évènement rend tout à coup insupportable » (Pierandrea Amato).
Plus largement, la révolte témoigne autant de l’instinct de survie que de la frustration relative maximale. C’est-à-dire la tension entre deux niveaux de représentations divergents : celui de l’activation des besoins et l’attente de biens et services que l’on considère comme légitimes, urgents et vitaux et celui des possibilités concrètes de satisfactions que l’on considère comme indûment restreintes et injustement inaccessibles.
Je soulignerai enfin que l’intensité́ et les impacts de toute révolte sont imprédictibles. Chaque révolte tire d’elle-même sa vérité́ fondamentale. Ici, les conséquences précèdent tout savoir qui les concerne. Le Printemps arabe est à ce titre fort illustratif. Se sédimentant progressivement dans les trames insaisissables de l’existence concrète, la révolte a surgi brusquement au détour d’un évènement banal pour devenir ce que l’évènement en a décidé́.
Mieux vaut prévenir que guérir
Relativement au Cameroun donc, l’antidote à une révolte potentielle, disais-je plus haut, n’est rien d’autre que la prévention. Celle-ci renvoie au triptyque dialogue-solidarité-justice.
Le régime Biya doit dialoguer avec son principal adversaire politique, Maurice Kamto afin de créer une convergence même seulement momentanée autour de la lutte contre cette pandémie qui menace la vie des camerounais indépendamment de leurs appartenances politiques, sociales, ethniques, culturelles ou religieuses. Au regard du récent communiqué d’Atanga Nji qui ne vise ni plus ni moins qu’à contrecarrer le succès populaire de la levée de fonds de Maurice Kamto, on ne peut pas dire que le régime ait pris la mesure de la dimension nécessairement transpartisane de la réponse au COVID-19.
Cette crise, j’insiste pour le dire, met en jeu notre capacité à faire front ensemble et non notre aptitude à être en opposition frontale les uns avec les autres. Les Tontons Macoutes du régime de Yaoundé seraient aussi avisés de comprendre que l’insécurité ou la fragilité de leur pouvoir en pareilles circonstances ne vient pas nécessairement de la puissance du MRC. L’essentiel de la fragilité du régime vient d’abord de l’échec de sa politique sociale. Je ne le dirai jamais assez : les inégalités sanitaires sont avant tout les inégalités sociales. Et on sait que, dans une chaîne, la résistance dépend non du maillon le plus fort, mais du plus faible. Il est donc inopportun en ce sens d’agiter ses bidasses et son pharisaïsme juridique pour empêcher les camerounais de recevoir une aide parce qu’elle provient d’une initiative du leader du MRC. Les intérêts supérieurs de la nation et même la recherche d’une certaine rentabilité politique suggèrent d’agir dans l’autre sens, comme l’a fait Macky Sall au Sénégal.
Du reste, le régime doit prendre les mesures d’urgence (solidarité institutionnelle) afin de limiter au maximum les effets économiques et sociales sur les camerounais en général et sur les couches pauvres et démunies en particulier (justice/équité).
Et demain, cet après COVID-19 qu’il faut malgré tout penser comme des êtres qui essayent d’inventer un lendemain incertain, il faudra rappeler à tous les gouvernants quel qu’ils soient que la santé n’est pas une dépense, c’est un « investissement ». Ce qui implique de réinventer l’État social qui a été laminé et décomposé par les institutions de Bretton Woods, mais aussi par la corruption, les mauvais choix, l’obsession sécuritaire, la luxure, la gabegie, le népotisme, le tribalisme, la médiocrité, le copinage et le mauvais cœur.